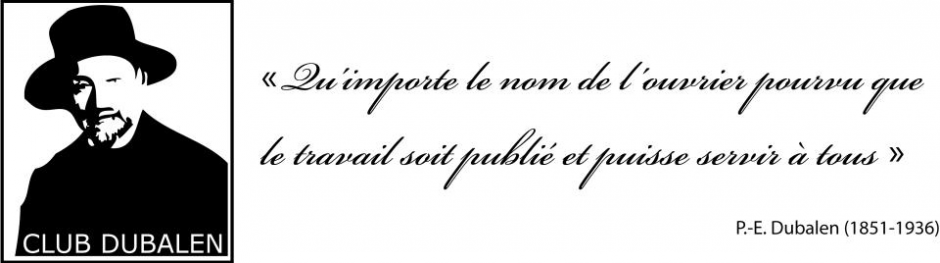Si vous êtes en train de lire ce blog, c’est qu’en principe, le Patrimoine de votre région vous intéresse -à moins que votre passage ici ne soit lié à un caprice des moteurs de recherches et à une indexation hasardeuse-.
A moins que ce ne soit déjà le cas, nous vous recommandons d’intégrer le réseau associatif des sociétés savantes régionales afin de vous permettre non seulement de vous tenir au courant de la vitalité des recherches locales, mais aussi éventuellement de vous permettre de publier sur un sujet qui vous intéresse.
En Aquitaine, quel que soit le département où vous vous trouvez, il y en aura au moins une pour satisfaire votre curiosité. Wikipédia en dresse une liste non exhaustive : http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_soci%C3%A9t%C3%A9s_savantes_d%27histoire_et_d%27arch%C3%A9ologie_en_France
Créée en 1876, la Société de Borda est aujourd’hui forte d’environ 1200 adhérents, soit une des plus importantes du Sud-Ouest. Chaque trimestre, elle publie un bulletin, regroupant des articles richement documentés (illustrations en noir et blanc et en couleur) sur des thématiques aussi diverses que l’Histoire, la Géographie, la Botanique, la Géologie, l’Archéologie, le Folklore etc. en relation avec le département des Landes. Hélas, beaucoup de landais, surtout à Mont-de-Marsan et ses environs, imaginent que la Société de Borda née et basée à Dax, n’est qu’un regroupement d’érudits dacquois vieillissant devisant entre eux du Patrimoine de Dax. Que nenni! Si la Société de Borda est bien née à Dax, la grande majorité des articles publiés ne traitent pas de Dax. De plus, la Société de Borda tient des réunions mensuelles publiques et gratuites un peu partout dans les Landes avec des conférences en relation avec la commune d’accueil ou son terroir proche. Enfin, si effectivement, à l’instar des sociétés savantes en général, la moyenne d’âge des adhérents et élevée, le Président actuel -et une bonne partie des membres du Conseil- a moins de 60 ans. Par ailleurs, des étudiants présentent régulièrement leurs travaux au cours des réunions mensuelles ou assistent en spectateurs à ces dernières.
L’adhésion se fait par paiement d’une cotisation annuelle qui donne droit à réception des bulletins trimestriels. Alors, n’hésitez plus, agissez pour votre Patrimoine et la sauvegarde de la mémoire de votre terroir et adhérez à la Société de Borda!
Lien : http://www.societe-borda.com/
Post Scriptum : nous avons rédigé ce billet en réaction d’une certaine manière à des « landais » du pays de Maremne vus dans un reportage récemment sur la chaine M6 (la rediffusion en ligne du reportage : http://www.m6replay.fr/emissions/#/zone-interdite/11305138-invasion-de-touristes-quand-les-habitants-se-revoltent). Ils se prétendaient landais, fiers de leur « identité », rejetant touristes et tout ce qui n’était pas à leurs yeux « landais », n’hésitant pas à dégrader des véhicules ou limitant finalement leur seule vision du Patrimoine local à des vagues et des bouts de plage qu’il faudrait à tout prix défendre contre d’improbables envahisseurs. Nous doutons fort qu’avec une telle optique, ces personnes adhérent un jour à la Société de Borda comme action « positive ». Mais il nous est apparu important de montrer aux lecteurs de ce blog que l’on peut aussi aimer un terroir et agir intelligemment. Les Landes n’ont aucune historicité, c’est un territoire créé de toute pièce arbitrairement à la Révolution. Tout en rejetant toute forme de xénophobie et de localisme, s’il avait été juste d’un point de vue historique de mettre en avant un territoire, ces bien tristes sires auraient été bien avisés de parler éventuellement de Gascogne. Mais quand on voit que les plaques d’immatriculation 32 (Gers) étaient arrachées au même titre que des plaques plus lointaines, on comprend à quel point leur connaissance de l’identité landaise, de l’Histoire de leur terroir est proche du néant. Même le chant qu’ils ont entonné n’était pas l’hymne landais pourtant bien connu dans le département, chanté par les anciens dans les réunions de famille ou à un comptoir de bistrot après une partie de quille ou de belote.