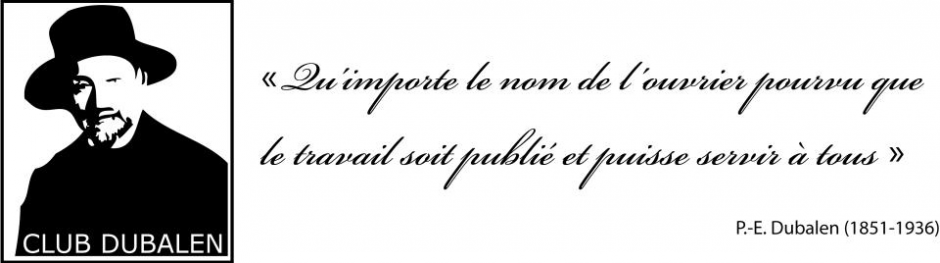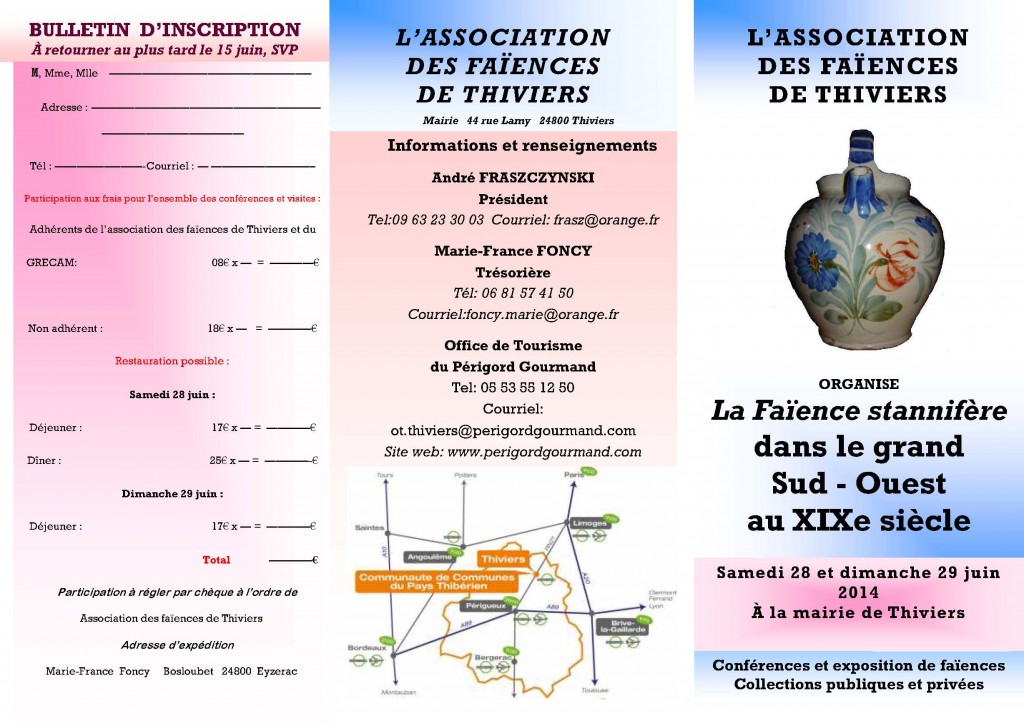Nous sommes nombreux à avoir un jour utilisé un des Atlas Historiques des Villes de France, fascicules hors-normes (en A3), condensant en 2-3 pages un maximum de données sur le peuplement et l’occupation du sol de villes choisies avec soin, plan cadastral retravaillé à l’appui. Depuis quelques années, exit les fascicules, ce sont de véritables ouvrages brochés qui sont désormais publiés. Pour le sud-ouest, nous retiendrons dans cette nouvelle version :
_ Oloron-Sainte-Marie, par Jacques Dumonteil, publié en 2003
_ Orthez, par Benoît Cursente, publié en 2007
_ Bordeaux, par Sandrine Lavaud (dir.) et Ezéchiel Jean-Courret (carto.), publié en 2009.
Les trois ont été publiés, non plus par le CNRS comme les fascicules grand format, mais par les éditions Ausonius : http://ausoniuseditions.u-bordeaux3.fr/fr/index.php/collections/atlas-historique-des-villes-de-france
L’histoire de ces documents de grande valeur scientifique (même si les progrès de l’archéologie préventive ont parfois remis en cause quelques données… et souvent confirmées d’autres) remonte à plusieurs dizaines d’années. Une étude sur le sujet a été mise en ligne par l’institut Ausonius (http://ausoniuseditions.u-bordeaux3.fr/fr/PDF/ATLAS.pdf); nous nous permettons d’en citer un passage pour précision :
« La collection de l’Atlas historique des villes de France relève de la Commission internationale pour l’histoire des villes ; celle-ci, lors de sa fondation en 1955, a lancé un programme de cartographie historique des villes à l’échelle européenne, auquel s’est associée la France. La CIHV, qui est rattachée à la Commission Internationale pour les Sciences Historiques, a un rôle d’échanges et de plate-forme de discussions entre partenaires européens. En matière de réalisation des atlas, elle a assuré l’harmonisation des collections, ainsi que l’indexation des productions.
Le modèle d’atlas français a débuté en 1973 sous l’égide de Philippe Wolff, professeur à l’université de Toulouse, alors président de la CIHV, et de Charles Higounet, professeur à l’université de Bordeaux et directeur du Centre de Recherches sur l’Occupation du Sol et du laboratoire de cartographie historique qui lui était associé. Bénéficiant des acquis des atlas anglais (1969) et allemands (1972) qui avaient posé les principes de l’entreprise, les deux fondateurs ont élaboré la maquette en fonction des spécificités nationales, notamment celles de sa source cadastrale napoléonienne. En 1982, les premiers atlas français sont publiés sous la nouvelle direction de Jean-Bernard Marquette, professeur à l’université de Bordeaux. Les 48 fascicules produits sous son égide (1982-2007) ont permis une couverture dense de certaines aires régionales telles l’Aquitaine, Midi-Pyrénées, Bretagne ou encore Lorraine et Franche-Comté. L’édition est d’abord assurée par le CNRS qui se charge de la diffusion puis, à partir de 1996 lors de la création du laboratoire de recherche Ausonius (UMR 5607, CNRS Université Bordeaux III) auquel le programme atlas est rattaché, par les éditions Ausonius. »
Nous nous proposons de consulter certains des fascicules, ancienne version. Ils sont épuisés depuis quelques années, mais restent précieux et souvent introuvables dans les médiathèques locales :
_ Mont-de-Marsan, par Jean-Bernard Marquette, publié en 1982
_ Saint-Sever, par Jean-Claude Lasserre, publié en 1982
(prochainement : Bayonne, Pau, Tarbes, Bazas, La Réole, Auch)