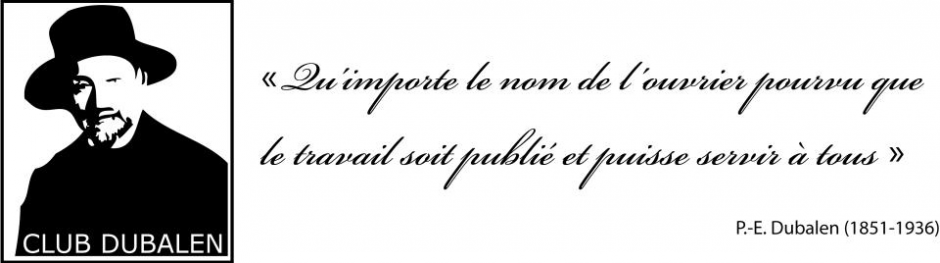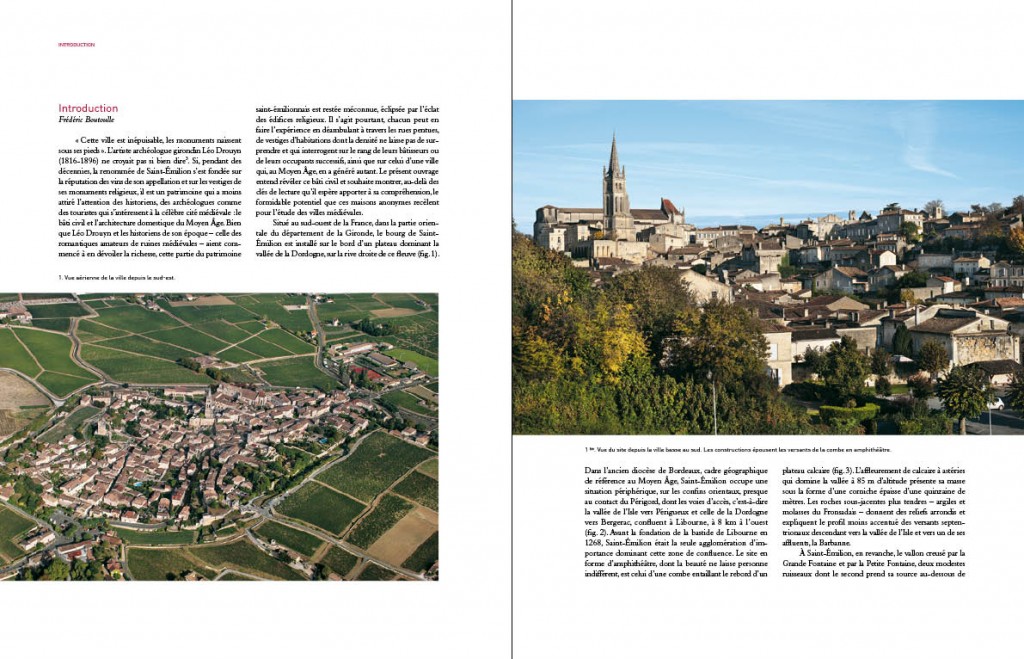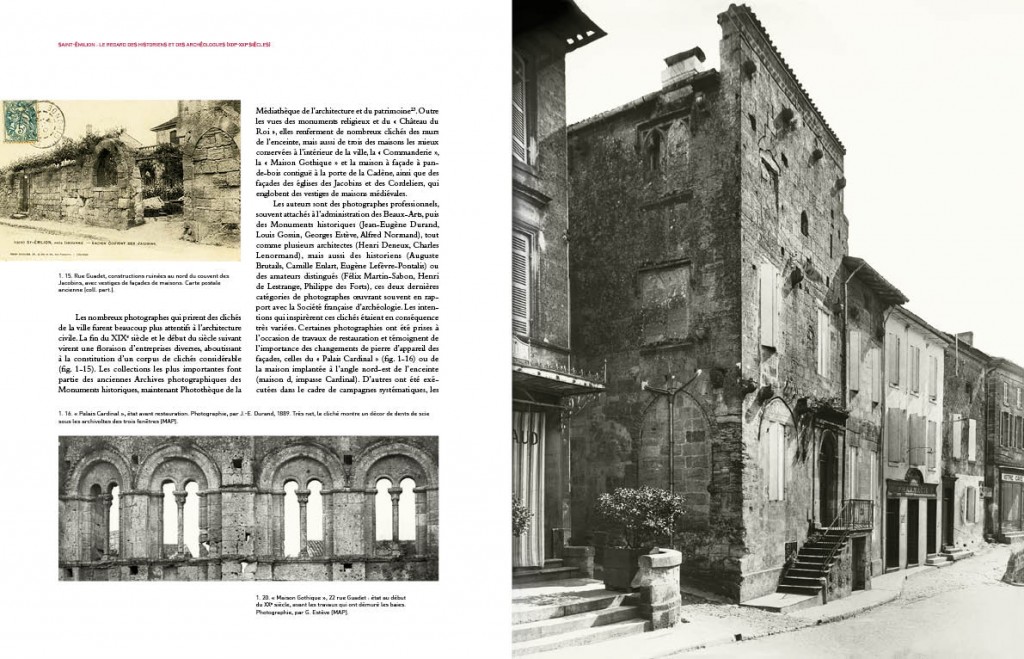sylvain lapique
saintjeandeluz@sudouest.fr
On a tout dit et tout écrit sur les Cascarots. Qu’ils étaient des Cagots, des Bohémiens, des indigents de petite vertu ou encore… des Cathares ! Dans une très sérieuse encyclopédie, on peut même lire en face de « Cascarots » : « Nom donné aux pêcheurs de Ciboure ». Ni plus ni moins.
Jacques Sales a décidé de siffler la fin de la récré. Dans son ouvrage « étude sur les Cascarots de Ciboure », l’historien amateur se livre à une démonstration étayée sur les origines de cette mystérieuse population, dont le souvenir hante encore la mémoire collective des habitants de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. « J’aime la recherche et je voulais en finir avec les idées toutes faites, lance-t-il. Certaines théories ne tiennent pas la route, mais se propagent malgré tout, car on vit dans un monde de copié-collé. Or comme dit le proverbe : mille fois répété n’est pas vérité. »
Des Morisques aux Cascarots
Jacques Sales a donc mis de côté les a priori pour replonger dans les textes. Les archives de la Casa Velazquez de Madrid, les travaux des chercheurs espagnols, la généalogie cibourienne, la correspondance et la littérature de l’époque… Et selon lui, le doute n’est plus permis : les Cascarots étaient bien des Morisques, ces maures convertis au catholicisme en Espagne et chassés de la péninsule au tournant des XVIe et XVIIe siècles.
Selon les estimations, entre 500 000 et 900 000 Morisques auraient quitté l’Espagne entre 1520 et 1614, au gré des ordonnances des royaumes d’Espagne. Certains par le Nord-Est et la Catalogne, pour regagner le Maghreb via les ports français d’Agde et Marseille. D’autres par la Navarre pour passer les cols pyrénéens, sous l’influence notamment d’Henri IV – « l’Angela Merkel de l’époque », sourit Jacques Sales -, qui leur a ouvert les portes de son royaume, non sans arrière-pensées militaires et diplomatiques.
En 1610, on en dénombre 3 000 entre Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Ce sont eux, puis leurs descendants, que l’on nommera Cascarots à partir du XVIIIe siècle.
Abel Hugo, le frère de « l’autre », écrit d’ailleurs en 1813 dans « La France pittoresque » : « On trouve dans le Pays basque une race d’hommes que les habitants considèrent comme descendants des Sarrasins, et qu’ils désignent sous les noms de Agotac et Cascarotac. En les examinant de près, on distingue dans leur physionomie les caractères un peu affaiblis du sang africain ; ils ont même gardé quelques coutumes étrangères. »
Notamment une curieuse danse avec grelots et bâtons, au son d’une flûte à trois trous et d’un tambour joués simultanément par un même musicien. Toute ressemblance est bien évidemment fortuite…
Identité perdue
à travers le destin de cette communauté, Jacques Sales aborde la grande question de l’assimilation, avec ce qu’elle comporte d’identités perçues et d’identités perdues. Il déconstruit les amalgames, raccourcis et fantasmes qui se sont installés au fil des siècles dans l’imaginaire collectif, jusqu’à entraîner la confusion actuelle.
On a d’abord pris les Cascarots pour des Cagots, car ils appartenaient de fait à la marge de la société. Puis pour des Bohémiens, car ils se sont longtemps fait passer pour des membres de cette communauté afin d’échapper aux persécutions des autorités espagnoles. On les a résumés, enfin, à une vision romantique de femmes à la beauté sauvage, charriant les paniers de poissons frais entre les ports et les marchés de la côte, tout en vendant leurs charmes à l’occasion… « Aujourd’hui, certains Cibouriens se revendiquent Cascarots uniquement parce que l’un de leurs ancêtres était pêcheur, sourit Jacques Sales. Mais s’il est vrai que beaucoup ont trouvé de petits boulots dans la pêche, d’autres étaient charpentiers, artisans et même, pour ceux qui sont arrivés avec de l’argent, capitaines de navire… »
Environ 300 Morisques ont ainsi fait souche à Ciboure, se mariant au fil des siècles à des Basques ou des Gascons, adoptant les coutumes et la langue locales, jusqu’à en égarer leur identité propre.
Une identité que Jacques Sales leur rend aujourd’hui avec un malin plaisir.
« étude sur les Cascarots de Ciboure », de Jacques Sales, 62 pages, 16 euros. Disponible sur les plateformes Internet de vente en ligne, à la librairie Louis-XIV de Saint-Jean-de-Luz et en libre consultation dans les bibliothèques de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure.