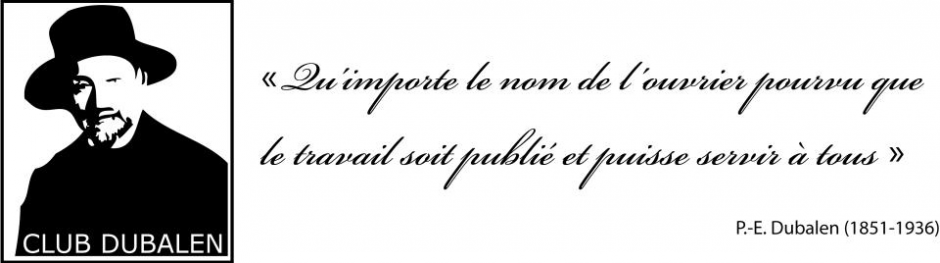Il est des privations de liberté sans geôliers ni barreaux, où l’entrave est tout aussi durement ressentie. Voilà sept mois que le Montois Didier Vignaud, 44 ans, est confiné, la peur au ventre, sur une base de vie sécurisée dans le sud Sahara algérien. Chargé de la construction d’une centrale électrique à Hassi R’mel par le géant américain General Electric, cet ingénieur passionné d’archéologie et d’aéromodélisme vit « une histoire digne de James Bond », depuis novembre dernier.Le 19 du mois, dix jours après une visite de la commission de sécurité de la Wilaya (équivalent de la préfecture en France, NDLR), onze militaires algériens débarquent dans son bureau.
« Je n’ai eu aucune sommation, aucune explication. Ils m’ont juste dit qu’ils étaient là dans le cadre d’une procédure administrative, diligentée par le procureur général », témoigne-t-il depuis le site Hassi R’mel.Les envoyés militaires lui confisquent son passeport et ses ordinateurs et exigent les codes de ses comptes informatiques. De perquisitions en interrogatoires, ils lui posent mille questions sur son passé, sa vie privée. Jusque-là dans le flou, Didier Vignaud fait le lien avec une caméra numérique et un hélicoptère télécommandé saisis quelques jours plus tôt par la Wilaya.
Le verdict ce dimanche
Seul face aux hommes du Département de renseignement et de la sécurité (DRS), équivalent algérien de notre DST/DGSE, le Français se rapproche du doyen des avocats de Laghouat et écarte les soupçons appuyés d’espionnage. Mais il reste poursuivi pour l’utilisation de ces « jouets pour adultes » considérés comme hautement suspects mais dont des milliers d’exemplaires volent en Algérie. La procédure traîne jusqu’au 7 juin, date à laquelle le procureur général du tribunal de Laghouat réclame 1 an de prison ferme, une amende de 10 000 euros, et bien sûr la confiscation de son matériel.
Le jugement doit tomber ce dimanche (un jour de semaine en Algérie, NDLR). En attendant, Didier Vignaud tremble…
Vraiment « incroyable »
L’affaire est kafkaïenne. L’ancien technicien de la Base Aérienne 118 a construit des plates-formes pétrolières au Nigeria et en mer du Nord. Il a piloté l’édification d’une centrale électrique algérienne à Relizane avant d’en terminer une seconde à la frontière tunisienne, « sans aucun problème ». Sur le chantier d’Hassi R’mel, le passionné d’aéromodélisme mais aussi de vieilles pierres (il est bénévole actif au Centre de recherches archéologiques des Landes, NDLR) a rapporté un quadricoptère pour son loisir.
Son tort? Prendre régulièrement des clichés du chantier dans l’intérêt et à la demande de son employeur et du client…
Le « drone avec caméras sophistiquées de type infrarouge » dont a entendu parler la Sûreté algérienne suite à une dénonciation renvoie en réalité à un engin à hélices de 30 centimètres de diamètre sur lequel il est possible d’installer une caméra de type GoPro. Dans ses échanges avec le Montois, le consulat de France à Alger évoque une situation « incroyable ». « Tout ceci est complètement absurde car tenter d’espionner l’Algérie avec un quadricoptère, ce serait comme essayer de voir les côtes américaines depuis la pointe bretonne », image-t-il ébahi.
L’affaire le dépasse. Mais l’expatrié lutte. Jusqu’en janvier, le père célibataire en charge de deux enfants ne dit rien à ses proches, seulement qu’il est retenu pour raisons professionnelles. Didier compte les jours autant qu’il se prépare. « J’ai fait un rapport sur tout ce qui m’est arrivé. Pour attirer l’attention j’avais aussi posté plusieurs reportages sur YouTube. L’ambassade et le consulat m’avaient ensuite incité à les retirer », témoigne celui qui a déjà fait l’objet de plusieurs articles de presse en Algérie.
Lâché par son entreprise
« La justice me reproche d’avoir réalisé des prises de vue de sites économiquement sensibles, mais je ne faisais que des photos de mon site avec l’accord des responsables de la sécurité ! Elle me reproche aussi de ne pas avoir eu d’autorisation officielle des douanes pour entrer sur le territoire algérien avec mon modèle réduit. Mais ce produit ne figure pas dans leur liste de produits interdits », se défend celui qui a eu le malheur de perdre la « déclaration de valeur » faite à son arrivée.
Placé sous contrôle judiciaire pendant cinq semaines, Didier Vignaud est officiellement libre de se déplacer en Algérie depuis février. « Mais sans passeport cela reste impossible », explique-t-il dans la douleur. Le pire est sans doute arrivé en avril, avec le décès d’une sœur dans un accident de voiture. « Malgré toutes les preuves fournies et les demandes officielles je n’ai pas pu rejoindre ma famille », ressasse-t-il encore et encore.
À la veille du jugement, le manque de ses enfants, de ses parents et de sa liberté se mêle à l’angoisse et à la colère. « Je ne suis qu’un simple expatrié français en Algérie, je n’ai rien fait pour mériter ce tel déploiement de force et je trouve cette situation inadmissible », dénonce-t-il à bout de force.
Didier Vignaud est amer. Il en veut particulièrement à son employeur, qui « profitait des photos » au même titre que le client algérien. « On m’a répondu que mon problème avec la justice algérienne était personnel et que la multinationale n’avait pas à s’en mêler », rapporte-t-il en dénonçant sans ambage un grave défaut d’assistance.
À la veille du verdict, le Montois se rassure comme il peut à travers les paroles de son avocat. « Il pense que je n’irai pas en prison », lâche-t-il avec un détachement de circonstance. Il faut avoir les nerfs solides.
« On a vraiment hâte que ça se termine… »
À Mont-de-Marsan, les parents venus gérer la maison de la rue de l’Argenté le temps de sa mission en Algérie sont « sous le choc » depuis l’annonce des faits, en janvier, alors qu’il était au plus bas. Monique et Dominique restent autant qu’ils peuvent en contact avec leur fils retenu en Algérie. Mais ils se sentent dramatiquement « impuissants ».

« Le problème c’est qu’il n’y a rien dans ce dossier. S’il avait acheté le matériel sur place il n’y aurait même pas de procès », commente, fatigué, le père et grand-père de la famille. Le couple fier de celui qui a a employé directement 2 500 Algériens et participé à la construction de centrales qui produisent de l’électricité pour près de 2,5 millions d’Algériens a lui aussi essayé de faire bouger les lignes. Mais le ministère des Affaires étrangères a vite conseillé de « ne pas trop faire de bruit ».
Le coup est dur à avaler. Et les parents par procuration de deux adolescents commencent vraiment à trouver le temps long.
Une passion d’enfance
« L’essentiel maintenant c’est que ça s’arrête, qu’il revienne », espère de tout cœur la maman de l’ingénieur expatrié. Pour la jeune retraitée, Didier restera toujours cet enfant calme et appliqué qui allait acheter ses maquettes sur le Cours de l’intendance, à Bordeaux. Ce petit garçon resté accroché à ses rêves d’avion. Et qui continue encore, passé 40 ans, à jouer avec ses modèles réduits comme d’autres font du tennis ou une partie de golf.
Ses enfants de 15 et 18 ans ont été autant préservés que possible et n’en parleraient pas trop. « Ce n’est pas évident. On tient le choc comme on peut. Mais on a vraiment hâte que ça se termine », concluaient hier les parents.
Le couple originaire de Bordeaux semblait aussi épuisé que Didier. Et sans doute encore plus inquiet.
V. D.