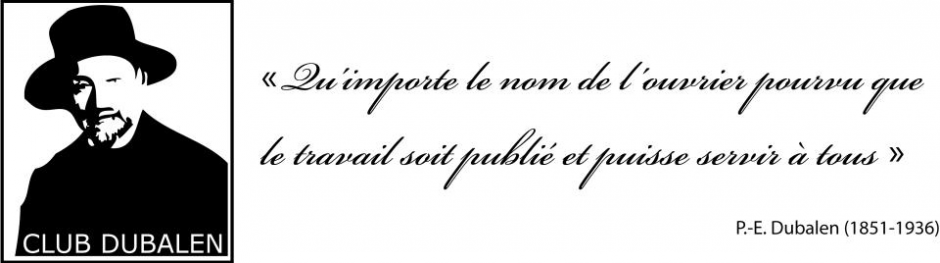On croirait parfois que les municipalités découvrent des dispositifs législatifs pourtant courants et largement assimilés par les collectivités territoriales : tout aménagement d’ampleur fait l’objet d’un diagnostic archéologique au préalable, qui ne retarde en rien les travaux puisque le timing est mis en place en concertation avec l’aménageur et donc inscrit au calendrier. Son financement est réalisé grâce à la redevance d’archéologie préventive.
Si le diagnostic est négatif ou positif mais les vestiges mal conservés ou trop épars, l’INRAP établissement public agréé pour de telles recherches rend son rapport et le chantier démarre.
Si le diagnostic est positif avec existence de structures inédites ou susceptibles de documenter grandement la connaissance que l’on a du Passé dans un territoire donné, rapport est rendu et ce rapport lance une nouvelle procédure, celle de la fouille. L’État, après examen du rapport, établit un cahier des charges à l’usage de l’entreprise qui sera choisie par l’aménageur après appel d’offre pour réaliser la fouille.
Sur un principe « pollueur payeur » qui s’applique aux entreprises polluantes pour limiter les rejets nocifs dans l’environnement, le Code du Patrimoine intègre la loi sur l’archéologie préventive qui part du principe « destructeur payeur », à savoir que le coût de la fouille incombe à l’aménageur. Cette loi n’est pas nouvelle puisqu’elle remonte au 17 janvier 2001. Les élus ou les gros aménageurs qui font encore les « vierges effarouchées » ne dupent personne, sauf parfois les journalistes… Si l’aménageur est un particulier, une petite entreprise ou une petite collectivité et que le coût des fouilles se révèle trop onéreux, il est possible de faire appel au Fond National pour l’Archéologie préventive.
La Régie des eaux de la commune d’agglomération du Marsan (Landes) semble découvrir aujourd’hui ce dispositif, quand bien même la ville a été largement concernée depuis plus de 20 ans par des fouilles préventives, menées principalement dans l’hypercentre. Il est vrai que c’était sous une autre équipe municipale. Autre temps, autres moeurs, peut-être, mais la loi reste la même et nul n’est sensé ignorer la loi, surtout en matière d’aménagement et étant donné le nombre conséquent d’aménagements réalisés ces dernières années à Mont-de-Marsan, on aurait pû se dire que le dispositif de l’archéologie préventive était connu et avait été largement assimilé. Que nenni comme semble nous le dire l’article paru ce jour dans le quotidien Sud Ouest à propos du différent qui oppose la Régie des eaux évoquée ci-dessus à l’Etat, représenté par le Service Régional de l’Archéologie basé à la DRAC Aquitaine à Bordeaux (source : http://www.sudouest.fr/2016/01/07/les-richesses-du-sous-sol-entrent-en-concurrencenombreux-indices-archeologiques-2235721-2485.php) :
Mont-de-Marsan : Géothermie et vestiges archéologiques face-à-face
Publié le 07/01/2016 à 12h13 , modifié le 07/01/2016 à 12h13 par
Benoît Martin
La Ville veut construire un bassin de stockage pour les eaux de l’un de ses forages à Mazerolles. Sauf que le site recèle des vestiges datant de l’âge de bronze

Les découvertes des premières fouilles en mars 2014 ? « C’est comme si le ciel nous était tombé sur la tête », explique Le conseiller municipal montois délégué à l’eau et aux énergies renouvelables, Thierry Socodiabéhère. ©Florence Cavalin
«Cherche entreprise pour effectuer des fouilles archéologiques préventives, préalablement à la construction du bassin de stockage des eaux géothermiques de Mazerolles. » Voilà l’avis d’appel public à la concurrence publié par la Régie municipale des eaux et de l’assainissement de Mont-de-Marsan, le 21 décembre. Les candidats ont jusqu’au 29 janvier pour envoyer leur offre.
L’entreprise choisie aura l’auguste honneur de déterminer qui du crétacé supérieur (- 100 à – 65 millions d’années) ou de l’âge de bronze (de 5 000 à 3 000 av. J.-C.) l’emportera. Peu de Montois le savent, mais c’est un vrai choc de l’histoire qui se joue sur la commune de Mazerolles, à une poignée de kilomètres à l’est de Mont-de-Marsan. Rien n’est visible. Tout est en sous-sol.
Vieille eau chaude
Le premier puits, exploité depuis 1975, alimente en chauffage la Base aérienne 118, l’hôpital Sainte-Anne, la résidence Hélène-Boucher, l’école de l’Argenté et depuis peu le quartier du Peyrouat. Le second puits, exploité entre 1984 et 2006, et rouvert depuis 2014, vient chauffer la caserne Maridor. « En 2014, le volume pompé total s’élève à 1 053 604 m3 pour le GMM 1 et à 206 575 m3 pour le GMM 2, précise la Régie des eaux. Pour l’ensemble des quatre abonnés – BA 118, hôpital Sainte-Anne, Hélène-Boucher, Maridor -, la géothermie a permis d’éviter le rejet de 2 395 tonnes de dioxyde carbone. »
Vestiges d’occupation
De quoi s’agit-il ? Mont-de-Marsan est assis sur un trésor : une gigantesque nappe d’eau naturellement chaude (55 à 60°C), enfouie à environ 1 800 mètres de profondeur, formée il y a donc près de 100 millions d’années. Deux puits de forage – le GMM 1, situé avenue de Nonères, et le GMM 2, sur la zone industrielle du Carboué – envoient cette eau chauffer une bonne partie des Montois, pour un impact environnemental et un coût financier bien inférieurs à ceux des énergies fossiles ou nucléaires (lire ci-contre).
Une fois qu’elle a servi de chauffage, l’eau venue des profondeurs doit être encore valorisée en surface. Il est normalement interdit de la rejeter dans les cours d’eau, comme ça, sans rien en faire. D’où ce projet de bassin de stockage des eaux du forage GMM 2 à Mazerolles, à proximité du hameau de Beaussiet. Objectif de ces « stocks » d’eau : permettre l’irrigation de 150 hectares de culture, aux environs, en bordure de Midou, traditionnellement confrontés à de sévères restrictions de pompage.
Comme les terrassements induits par le projet, de par « leur nature, leur importance et leur localisation », étaient « susceptibles de mettre au jour des vestiges d’occupations protohistoriques et antiques », les services de l’État ont prescrit des premières fouilles. Effectuées en mars 2014, par une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), ces premières recherches ont donné des résultats intéressants, détaillés dans un rapport de 200 pages (lire ci-dessus). Des résultats qui méritent d’être approfondis via de nouvelles fouilles plus conséquentes.
« L’État doit assumer ! »
Le conseiller municipal montois délégué à l’eau et aux énergies renouvelables, Thierry Socodiabéhère, se serait bien passé d’un tel cadeau tombé du sol plus que des cieux. « C’est un peu comme si le ciel nous était tombé sur la tête. Mais la Régie est obligée d’entrependre ces fouilles », explique l’élu, en référence à l’arrêté préfectoral signé par la conservatrice régionale de l’archéologie, pour le compte du préfet de Région, le 30 juillet.
La Ville a eu beau solliciter une dérogation… Rien n’y a fait. Ces fouilles, il faut les faire. Un point c’est tout. 12 semaines et 12 personnes minimum pour fouiller plus de 2 hectares. « On parle de 500 000 à 600 000 euros, bien évidemment à la charge du maître d’ouvrage, la Régie des eaux, râle Thierry Socodiabéhère. Cela va se répercuter de facto sur le prix du mégawattheure (MWh). Aujourd’hui, on est à 52,50 € TTC/MWh. Aux dernières nouvelles, la BA 118 pourrait se fournir au gaz à 57 euros TTC/MWh. Je crains qu’en intégrant les coûts des fouilles, la géothermie ne soit plus compétitive. »
« Que l’État assume ses responsabilités et cette découverte majeure et subventionne les fouilles ! », appuie Thierry Socodiabéhère. « Si on ne peut pas tenir nos objectifs économiques et que l’État ne veut pas prendre de dérogation, on arrêtera tout. Et la Régie se réserve le droit de se retourner contre lui, en justice, pour défauts de conseil dans le montage des dossiers depuis 2010. Ces quatre dernières années, la Ville a investi cinq millions d’euros dans la géothermie. Je ne vais pas mettre la Régie et les Montois dans le rouge pour l’État. S’il est prêt à mettre en jeu l’avenir pour protéger le passé, qu’il assume jusqu’au bout ! »

Le conseiller municipal montois, Thierry Socodiabéhère.© Photo pascal bats
Nombreux indices archéologiques
« Le diagnostic d’archéologie préventive des parcelles destinées à accueillir un bassin de stockage des eaux issues du forage géothermique GMM 2, sur la commune de Mazerolles, a mis en évidence des vestiges d’occupation datant respectivement de l’âge de bronze, de la fin de l’âge de fer et du Haut-Empire. » Voilà ce qui a fondé l’arrêté pris le 30 juillet, décision du préfet de Région, de « prescrire des mesures complémentaires de sauvegarde via des fouilles préventives ». Effectuées en mars dernier par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) sur 2 800 mètres carrés, les « pré-fouilles » ont mis en évidence « une trame relativement continue d’indices archéologiques » : tessons, fragments de céramiques et de torchis, silex, trous de poteaux, etc. Le diagnostic conduit notamment à proposer « l’hypothèse d’une ferme indigène installée à la fin de l’âge de fer. Ce type d’établissement, bien connu au nord de la Garonne, n’est en revanche pas documenté à ce jour dans l’espace landais et le bassin de l’Adour. L’étude de l’évolution du site (habitat, bâtiments agricoles, greniers, etc.) est susceptible d’apporter des données novatrices sur les modalités d’organisation des espaces ruraux à l’époque antique. »